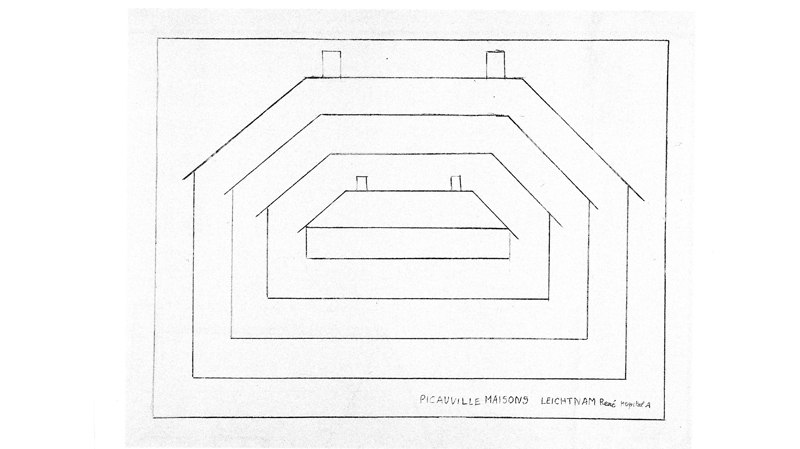Les Tender Session se sont des rencontres qui proposent un temps d’échanges au cours des résidences/création. Le public est invité à collaborer au développement d’une création en cours, et ce selon les besoins spécifiques des artistes en résidence. L’artiste adressera des questions, fera expérimenter des nouveaux dispositifs, outils, demandera de remplir un questionnaire ou de … C’est selon. Nous vous invitons à être au service d’un·e ou plusieurs artistes pendant une heure ou deux. Ces échanges sont intellectuellement tendres et riches, et l’écoute de tou·tes envers chacun·e est attentionnée.
Lors de l’édition 2018 des rencontres photographiques d’Arles, une grande exposition était consacrée à Fernand Pouillon, un célèbre architecte français de l’après-guerre.
«Construire à hauteur d’homme» était une rétrospective de l’œuvre algérienne de l’architecte s’intéressant particulièrement aux grands ensembles - aussi appelé cités, construite dans l’ancienne colonie. D’origine algérienne mais tout à fait étranger au territoire et à l’architecture du pays, je me suis rendu à cette exposition. Elle regroupait une série de photos des constructions les plus célèbres de l’architecte - certaines aux noms évocateurs tels que «Cité du Bonheur» ou
«Climat de France», toutes construites autour d’Alger au début des années 50. Sur certaines photos les blocs d’immeubles étaient magnifiés par la lumière rasante du lever de soleil.
Sur d’autres, plus documentaires, on pouvait voir les habitant·es de ces cités dans leur quotidien de l’époque.
Plus j’évoluais dans l’exposition et plus ce décor et ce quotidien me semblaient familiers.
Tout dans ces photos me rappelait les cités où j’ai moi-même vécu, non pas en Algérie mais en France : les proportions des bâtiments, leur hauteur, le béton, les longs et étroits couloirs desservant des dizaines d’appartements par paliers, les immenses parvis de béton. Tout, jusqu’aux personnes qui peuplent ces immeubles : sur les photos des «indigènes» des années 50, dans mon enfance des algérien·nes immigré·es dans les années 80. L’analogie était telle que j’ai à plusieurs reprises vérifié les légendes pour confirmer que ces clichés, qui dataient de l’Algérie occupée, n’avaient pas été pris en réalité aujourd’hui en banlieue française.
J’étais venu découvrir des photos d’un passé et d’un ailleurs, et je fus projeter dans le milieu où j’ai grandi.
Je suis né aux «Beaudottes» en Seine-Saint-Denis, une cité construite en 1981, largement inspirée par les préceptes de Pouillon en termes de bâti : la même architecture dite brutaliste.
Au-delà de la correspondance esthétique, j’ai commencé à entrevoir à travers ces photos une même volonté politique. Avec 30 ans et des centaines de kilomètres d’écart, ces cités «du Bonheur» ou «des Beaudottes» répondaient peut-être à la même logique urbanistique, la même politique ségrégationniste en situation coloniale comme post-coloniale.
Formé à l’ESACT de Liège, Salim Djaferi est acteur, auteur et metteur en scène