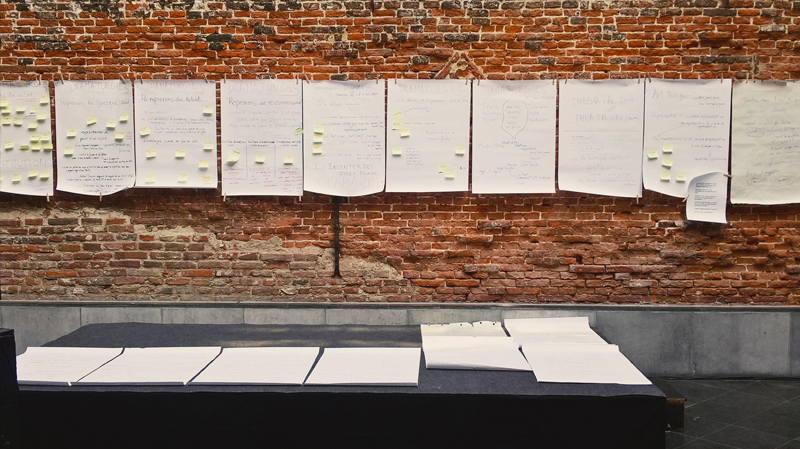Objectifs spécifiques des séminaires
Plus qu'à une histoire ou à une théorisation de la dramaturgie, les participant.es sont ici invité.es à saisir, cerner et pratiquer la dramaturgie en s'essayant à la fois à dresser une cartographie des pratiques dramaturgiques et à pouvoir s'y situer. Il s'agit ainsi non pas de définir une pratique qui, en tant que telle, sort du cadre définitionnel puisqu'elle n'a pas de « fins » et de contours fixes et figés – ceux-ci bougent selon les modalités d'activation dramaturgique (au plateau, en institution, dans la conception de dispositifs divers...) – mais plutôt de proposer une méthode de double singularisation : singulariser ce qui fait, aujourd'hui, le paysage dramaturgique et ainsi voir apparaître, pour chacun·e, ce qui singularise sa propre méthode de faire. À partir de là s'entame un chemin d'étude situé, le long duquel le/la participant·e peut davantage reconnaître la spécificité de sa méthode, de ses outils mais aussi, par-là, expérimenter d'autres manières d'en faire usage ou de les affiner en regard des spécificités des autres.
Les séminaires : 4 correspondants à des activations différentes de la dramaturgie aujourd’hui.
Orientation : partage de savoir et mise en expérimentation. Partir d’une problématique à laquelle le ou la praticienne invité·e fait face et ouvrir cette recherche ou réflexion plutôt que de faire une présentation d’un savoir. Il s’agit d’une mise au travail et en partage plutôt que d’une formation académique.
Chaque séminaire, étendu sur une semaine, implique :
-L'intervention d'un·e praticien·e dramaturge, choisi·e et invité·e en ce qu'iel active l'une des modalités spécifiques de cette activité et peut ainsi en dresser les enjeux singuliers auprès des participant.es.
-Il s'agit aussi, pour chaque intervenant·e, de pouvoir mettre en partage des outils, des protocoles de recherche et d'écriture ou encore de proposer des situations permettant l'application de ce type-là de dramaturgie.
Chaque module incarne ainsi, à l'échelle concentrée d'une semaine, l'esprit général et transversal du programme « Pratiques dramaturgiques » : une circularité entre exposés et pratiques, entre parole de l'un·e et ressaisie collective, et partages de questionnements et expérimentations. Il s'agit de se mettre, au sein d'un espace de recherche et création artistique, en état « d'étude », c'est-à-dire d'alliance entre
« enquête » et « application » (cf. étymologie du mot).
Les modules seront donc toujours structurés en au moins deux temps : un temps « à la table » dans lequel le groupe est rassemblé pour se mettre à l'écoute et à la discussion d'une question, d'une problématique ; un temps d'expérimentation qui peut conduire les participant.es à un travail propre d'écriture, à une fréquentation d'une réalisation de plateau ou encore à la visite d'un autre lieu artistique ou un autre contexte selon le type de « dramaturge » qui intervient sur chaque module.
Pour qui :
Personne ayant une expérience de dramaturge, débutante ou confirmée.
Deuxième séminaire : Sortir de scène avec Camille Louis
Et si, pour une fois, on s'entrainait non pas à « mettre en scène » ni à « prendre la parole sur scène » mais plutôt à laisser l'une et l'autre ? Si on s'essayait à libérer l'espace, à le dégager d'un surplomb volontariste du Sens-à-incarner et si on accomplissait ce retrait en retenant sa parole y compris, et peut- être même surtout, celle que l'on prétend donner à - ou porter au nom de – tou.tes les pré-designé.es muet.tes de nos sociétés ? Que pourrait-il se passer si, en résumé, on apprenait non pas à entrer en scène mais bien à en sortir ? C'est-à-dire à se retirer, à retirer le « soi » et tout l’apanage du Sujet de cet espace autour duquel quelque chose comme une rencontre, une expérience sensible peut encore espérer se dérouler ?
Ces hypothèses n'ont rien d'un jeu heuristique abstrait. Elles viennent du concret des expériences, menées au croisement de la création dramaturgique et de l'engagement politique, et de ce que celles-ci façonnent en termes à la fois de soucis et d'espérances. Face à la profusion contemporaine de formes artistiques - souvent rangées dans le champ du « théâtre documentaire » - comme de celle de formations politiques qui, l'une comme l'autre, ne cessent de prétendre agir et parler pour (mais sans) les concerné.es, on ne peut que s'inquiéter de l'état des actes, de l'état des paroles, de l'état des actes parlés ou de celui des paroles actives -autrement qualifiées de performatives ou de dramatiques. Mais c'est aussi depuis cette inquiétude que l'on peut forger des espoirs en formes de questionnements partagés. Nous nous interrogerons donc, durant ce module, sur les différents procédés dramaturgiques à partir desquels on peut laisser la place et la parole non pas juste « aux autres », non pas juste à tel ou tel groupe-sujet auquel on dit s'intéresser (bien souvent lesdites minorités que, nommant ainsi, on minorise en effet...) mais bien à une forme de « nous » en formation, un « nous » sensible, expérimental, dissensuel et, par-là, politique plus qu'identitaire. Comment peut-on faire de la scène un lieu où se fabriquent des questions plus que celui où se donnent une leçon ou une série de résolution ? Comment peut-on, non pas disparaître, mais composer une forme de présence « en retrait », mi-marquée mi- effacée, une trace plus qu'une inscription trop affirmée ?
C'est en particulier depuis mon expérience de dramaturge auprès de la metteure en scène Léa Drouet et depuis les formes que nous concevons au croisement de l'enquête de terrain et de la fabulation (qu'il s'agisse des performances comme Violences ou J'ai une épée ou des dispositifs comme l'École Expérimentale) que j'aimerais ouvrir ces questions, amorcer des pistes de réflexion qui, elles, ne se poursuivront qu'en étant ressaisies par les participant.es au sein des exercices et expérimentations que nous tenterons et qui, chaque matin et surtout chaque fin de journée, rebattrons les cartes de nos interrogations.
Camille Louis est philosophe, dramaturge et activiste auprès des personnes en exil. Elle est la co- créatrice, avec Laurie Bellanca, du collectif interdisciplinaire kom.post avec lequel elle multiplie les interventions, au croisement de l'artistique et du politique, en de nombreux pays. Elle est dramaturge associée à La Bellone, Bruxelles, le fut au théâtre Nanterre Amandiers aux côtés de Philippe Quesne et collabore plus spécifiquement aujourd'hui avec Léa Drouet, Phia Menard, Frédérique Aït-Touati ou encore Nina Santes. Son premier livre, La conspiration des enfants (PUF, 2021) part de ses expériences de terrain (Lesbos, Athènes, Calais...) auprès des vies minorisées, assignées à minorité et qui sont, dans cette fable politique, remises à hauteur de leur puissance d'action et de résistance. Son prochain livre, La fabrique des yeux secs, existe déjà avant sa publication finale prévue à La Découverte, sous divers formats performatifs réalisés en collaboration avec Laurie Bellanca.