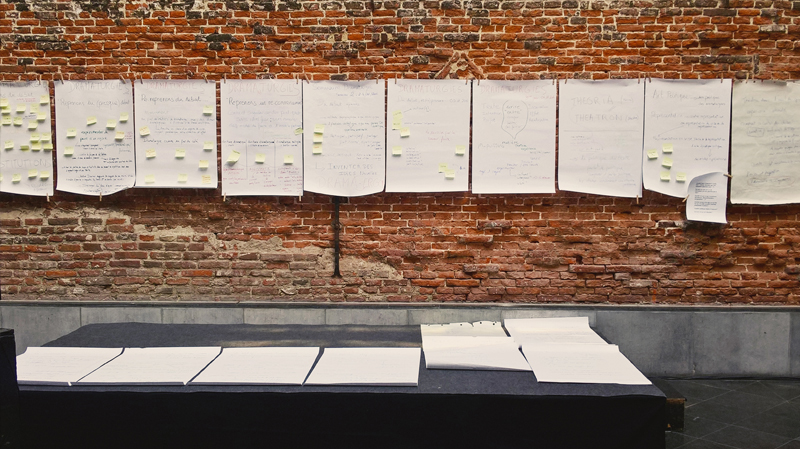
Dramaturgie documentaire avec Arnaud Timmermans
Objectifs spécifiques des séminaires
Plus qu'à une histoire ou à une théorisation de la dramaturgie, les participant.es sont ici invité.es à saisir, cerner et pratiquer la dramaturgie en s'essayant à la fois à dresser une cartographie des pratiques dramaturgiques et à pouvoir s'y situer. Il s'agit ainsi non pas de définir une pratique qui, en tant que telle, sort du cadre définitionnel puisqu'elle n'a pas de « fins » et de contours fixes et figés – ceux-ci bougent selon les modalités d'activation dramaturgique (au plateau, en institution, dans la conception de dispositifs divers...) – mais plutôt de proposer une méthode de double singularisation : singulariser ce qui fait, aujourd'hui, le paysage dramaturgique et ainsi voir apparaître, pour chacun·e, ce qui singularise sa propre méthode de faire. À partir de là s'entame un chemin d'étude situé, le long duquel le/la participant·e peut davantage reconnaître la spécificité de sa méthode, de ses outils mais aussi, par-là, expérimenter d'autres manières d'en faire usage ou de les affiner en regard des spécificités des autres.
Les séminaires : 4 correspondants à des activations différentes de la dramaturgie aujourd’hui.
Orientation : partage de savoir et mise en expérimentation. Partir d’une problématique à laquelle le ou la praticienne invité·e fait face et ouvrir cette recherche ou réflexion plutôt que de faire une présentation d’un savoir. Il s’agit d’une mise au travail et en partage plutôt que d’une formation académique.
Chaque séminaire, étendu sur une semaine, implique :
-L'intervention d'un·e praticien·e dramaturge, choisi·e et invité·e en ce qu'iel active l'une des modalités spécifiques de cette activité et peut ainsi en dresser les enjeux singuliers auprès des participant.es.
-Il s'agit aussi, pour chaque intervenant·e, de pouvoir mettre en partage des outils, des protocoles de recherche et d'écriture ou encore de proposer des situations permettant l'application de ce type-là de dramaturgie.
Chaque module incarne ainsi, à l'échelle concentrée d'une semaine, l'esprit général et transversal du programme « Pratiques dramaturgiques » : une circularité entre exposés et pratiques, entre parole de l'un·e et ressaisie collective, et partages de questionnements et expérimentations. Il s'agit de se mettre, au sein d'un espace de recherche et création artistique, en état « d'étude », c'est-à-dire d'alliance entre « enquête » et « application » (cf. étymologie du mot).
Les modules seront donc toujours structurés en au moins deux temps : un temps « à la table » dans lequel le groupe est rassemblé pour se mettre à l'écoute et à la discussion d'une question, d'une problématique ; un temps d'expérimentation qui peut conduire les participant.es à un travail propre d'écriture, à une fréquentation d'une réalisation de plateau ou encore à la visite d'un autre lieu artistique ou un autre contexte selon le type de « dramaturge » qui intervient sur chaque module.
Pour qui :
Personne ayant une expérience de dramaturge, débutante ou confirmée.
Premier séminaire : Dramaturgie documentaire avec Arnaud Timmermans
Il n’est pas rare qu’on identifie le travail de la dramaturgie à un travail sur les sources, les références, la théorie. En somme : sur la documentation du projet et la conceptualisation de sa « thématique » ou de son « sujet », qui sont supposées fournir les clés du développement artistique et les réponses aux questions formelles, méthodologiques, éthiques ou politiques posées par le travail de création. Du document, la dramaturge serait alors comme l’interprète, la traductrice, l’intercesseuse.
Pourtant, il n’est pas moins rare que ces mêmes références, devenue abondantes, viennent se mettre en travers des questions qui font la singularité du travail en cours, qu’elles produisent des effets d’intimidation ou d’autorité ou qu’elles suivent une logique propre qui peine à se transposer dans les formes d’un spectacle. D’interprète, le dramaturge se fait alors diplomate : car il s’agit de négocier les conditions d’un dialogue entre des travaux ou des objets dont les intentions resteront différentes, de ménager les écarts et les points de croisement, de mesurer les rapports de friction ou de redondance, d’interroger les logiques d’illustration ou de transposition... Bref, de choisir et d’aménager les régimes particuliers de relation aux documents et aux concepts dans l’écologie de la forme en train de se chercher.
Si ce ne sont pas les idées qui font un spectacle mais bien ses matériaux, de quels types singuliers de matérialité les documents relèvent-ils, dans leur diversité ? Quelle sont leur poids de réalité, leur texture propre ? Au-delà de ce qu’ils « énoncent » ou « racontent », de quelles séductions ou sévérités, de quels pièges font-ils parfois usage ? Si tout travail artistique vise à tenter de trouver une forme aux expériences, il faut aussi se demander de quelles expériences chaque document se fait le relais, pour cesser de le considérer dans sa prétendue autonomie et reparcourir le trajet dont il est la trace, l’inquiétude à laquelle il répond, le geste de pouvoir ou de résistance qu’il performe, le réel qu’il cherche à faire survivre, en un mot : le drama dans lequel il est lui-même déjà pris.
Ce séminaire abordera la question de la dramaturgie documentaire en cherchant à en retrouver, par la pratique, les potentiels dynamiques et dialogiques, plus proches de l’interaction que de la consultation. En se souvenant que documenter une dramaturgie peut aussi bien signifier la nourrir en documents qu’en produire la trace lisible et continuable par d’autres, on s’entraînera, par différentes pratiques de lecture et de (ré)écriture, à en explorer les réseaux mycéliens, à en réinventer les parentés et les généalogies, à en observer les bourgeonnements.
Après une expérience d'une petite dizaine d'années comme responsable de production dans des projets théâtraux assez variés en Belgique francophone, Arnaud Timmermans a entamé en 2017 une thèse en philosophie sur les relations étroites entre théâtralité, représentation et pouvoir à partir des travaux de Louis Marin. À partir de 2021, il travaille comme dramaturge auprès de différent·es créateur.ices de danse et de théâtre (Demestri+Lefeuvre, Anne-Cécile Vandalem, Baptiste Conte, Maïté Alvarez, Émilie Franco...), fait partie des dramaturges associés à la Bellone et participe au projet de critique expérimentale La Salve. En 2024, il rejoint l’équipe de La Bellone comme dramaturge responsable de la documentation.